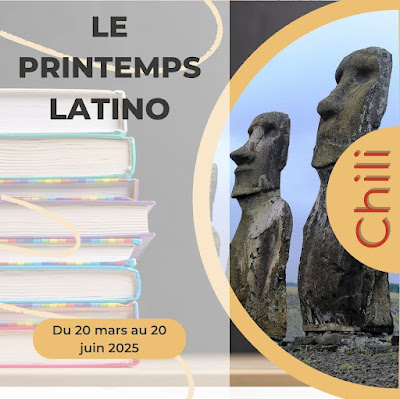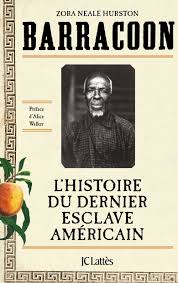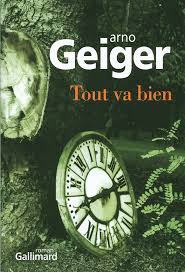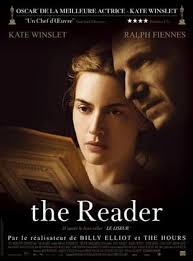Else-Maj, Jon-Ante, Marge, Anne-Risten… sont des enfants samis. Dans les années 1950, à l’âge de sept ans, on les a arrachés à leur famille pour les scolariser à l’école des nomades, un internat dirigé par « la sorcière », une femme haineuse et brutale qui bat les enfants au moindre prétexte. Pour l’État il s’agit de suédiser ces enfants : on leur interdit de parler leur langue ou de chanter des joïk (chant traditionnel sami), on modifie leur prénom. Par contre il est bienvenu qu’ils portent le costume traditionnel lors de la visite d’inspecteurs à l’école : on a voulu vider leur culture de sa substance et la transformer en folklore.
Trente ans plus tard, dans les années 1980, nous suivons les mêmes personnages devenus adultes. En apparence leurs vies ont été peu impactées par les violences dont ils ont été victimes. Petit à petit, cependant, des traumatismes profonds se révèlent.
Chaque chapitre du roman suit alternativement un personnage différent. Au départ un chapitre sur deux se déroule dans les années 1950, l’autre dans les années 1980. Il m’a semblé que cette alternance avait tendance à casser le rythme. Quand je commence à m’intéresser à une situation, on passe à une autre époque et à un autre personnage. A mesure qu’on avance dans la lecture cependant, l’action se concentre de plus en plus sur les années 1980 et la tension augmente.
Anne-Helén Laestadius est une autrice suédoise d’origine samie qui s’est inspirée pour écrire son roman de l’histoire de sa mère qui a fréquenté une école pour nomades.
C’est une lecture qui m’a plutôt intéressée et qui complète bien ma précédente. Ici aussi je retrouve, à l’époque contemporaine, un sentiment diffus de racisme à l’égard des Samis et l’emploi du mot « lapon » avec une volonté d’insulter.
Cette lecture me permet de participer au défi Auteurs des pays scandinaves.