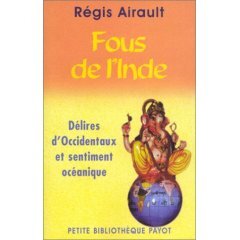Le romancier et historien militaire américain Caleb Carr est mort le 23 mai 2024, il était né en 1955. Il a grandi dans la crainte que son père, qui le battait, ne le tue. Le poète Lucien Carr avait en effet fait de la prison pour homicide involontaire. Le roman le plus connu de Caleb Carr est L’Aliéniste.

New York, 1896. Un tueur en série assassine de jeunes garçons prostitués puis mutile atrocement leurs cadavres. Le préfet de police Theodore Roosevelt charge le journaliste John Moore, narrateur du roman, et le médecin aliéniste (psychiatre) Laszlo Kreizler de débusquer le criminel. Ils s’adjoignent la collaboration des frères Lucius et Marcus Isaacson, deux policiers incorruptibles -espèce rare à l’époque- et de Sara Howard, secrétaire de Roosevelt, qui rêve d’enquêter -métier interdit aux femmes en cette fin du 19° siècle. Ils vont faire un travail de profileurs pour dresser un portrait de l’assassin et lui mettre la main dessus.
Laszlo Kreizler est un médecin en avance sur son temps qui pense que l’on peut trouver dans le passé -particulièrement l’enfance- des personnes déviantes des explications à leurs actes. Ces vues originales lui valent la réprobation de la communauté médicale établie.
Les frères Isaacson s’intéressent aux plus récentes découvertes de la criminologie comme l’utilisation des empreintes digitales. Leur intérêt pour la science ne frappe pas toujours juste. Ainsi ils photographient l’oeil d’une victime avec l’espoir qu’on pourra y voir le visage de son meurtrier.
Sara Howard est une femme décidée, prête à forcer les circonstance pour ne pas rester secrétaire. Elle sait manier le pistolet et n’hésite pas à tenir tête à Kreizler quand elle estime qu’il se trompe dans ses analyses.
Le narrateur est lui aussi légèrement marginal. J’ai trouvé cette petite équipe fort sympathique.
Le cadre historique et géographique est celui de New York à la fin du 19° siècle. La corruption règne dans les administration et la police où le préfet Roosevelt essaie de faire le ménage. Nos héros vont trouver en travers de leur chemin des chefs de gang qui n’apprécient pas qu’on intervienne sur leur terrain -prostitution et maisons closes- et même les autorités religieuses, désireuses que l’ordre social ne soit pas perturbé. L’auteur s’est bien documenté sur cette période et le résultat est vivant avec de nombreux détails sur la vie sociale et culturelle. Plus que l’enquête elle-même ce sont ce cadre ainsi que les enquêteurs qui me plaisent et qui m’intéressent dans ce roman. Ce que j’ai lu de la biographie de Caleb Carr me laisse penser qu’il a mis des éléments personnels dans ce policier.
La première de couverture nous parle d’un « scénario teinté de Silence des agneaux », affirmation qui m’a inquiétée car j’ai le souvenir d’une lecture qui m’avait horrifiée. En fait l’époque et le personnage de psychiatre éclairé me font plutôt penser à la série des enquêtes de Max Liebermann que j’avais beaucoup appréciée. J’ai trouvé cette lecture plaisante, l’auteur ne s’appesantit pas sur les horreurs commises par son assassin. Je vois qu’il existe un second épisode avec les mêmes enquêteurs, je le lirai sans doute.