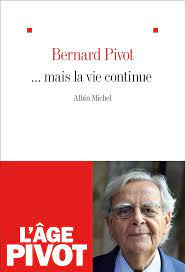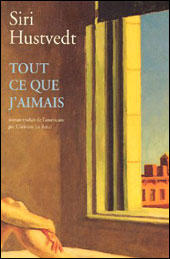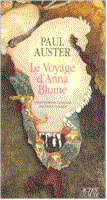Le romancier Bruno Combes est mort le 13 avril 2024. Il était né en 1962. Ingénieur chimiste, il publie son premier roman en 2014. Les trois premiers romans ont été publiés en auto-édition puis le succès lui a ouvert les portes de la maison Michel Lafon. Ses romans se classent dans la catégorie feel good et, à l’occasion de sa mort, je découvre à ma bibliothèque un rayon de romans feel good sous la côte RFG.
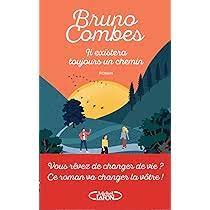
Il existera toujours un chemin. Margot, 32 ans, est mariée à un pervers narcissique alcoolique qui la bat. Un soir qu’il frappe plus fort que d’habitude elle craint de mourir et fuit le domicile conjugal. Elle se réfugie à Saint Jean Pied de Port dans la gîte tenu par Elaïa.
Alexandra, 25 ans, est une influenceuse basée à Dubaï. Elle se pose de plus en plus de questions sur le sens de son activité aussi, quand elle est trahie par son agent et compagnon, elle décide de rentrer en France. Direction Saint Jean Pied de Port et le gîte tenu par son amie Elaïa.
Fils d’un gros viticulteur du Bordelais Mathieu, 37 ans, a rompu avec ses parents mais pas totalement puisqu’il a acheté un domaine viticole en Espagne. Quand il fait faillite il plaque tout et s’en va sur le chemin de Compostelle.
Les trois personnages vont se rencontrer, se lier d’amitié et trouver ensemble le courage de faire de nouveaux choix.
Que dire ? Le style est plat, les dialogues sonnent faux et les réactions des personnages ne sont pas crédibles. Chaque chapitre est introduit par un court paragraphe, conseil de développement personnel à deux balles. Un exemple (j’ai choisi le plus problématique, à mon avis) :
« On peut rejeter notre éducation, notre enfance, nos origines, rendre responsables nos parents de tous les malheurs qui se présentent sur notre route. Les accuser de tous les maux, de nos hésitations, nos trahisons, nos faiblesses.
Mais, au fond, qui sommes nous pour ne rien assumer et pour faire preuve d’une telle lâcheté ?
Rien n’est écrit à l’avance, nous deviendrons ce que nous déciderons d’être.
Notre existence n’est dictée que par une seule chose : notre volonté ! »
Enfants battus ou victimes d’inceste, arrêtez de vous plaindre et faites preuve de volonté ! Vous l’avez compris, c’est du feel good pour ceux qui vont déjà bien. Et si nos personnages ont décidé de changer de vie, il ne s’agit pas de tout foutre en l’air : on respecte ses parents et on ne divorce pas quand on a un enfant en bas âge.
Malgré tout cela se lit sans difficulté et même avec l’envie de savoir où va me mener ce chemin : vers un monde sans chômage où une caissière de supermarché devient facilement salariée d’une ONG, une influenceuse productrice de fromage et un viticulteur failli photographe pour un éditeur. Du moment qu’on a la volonté. Et les bonnes relations…