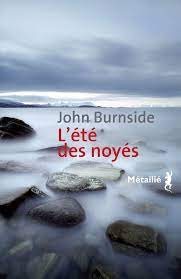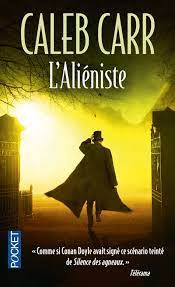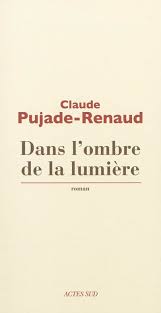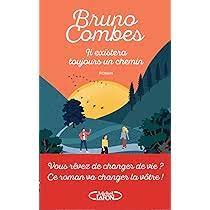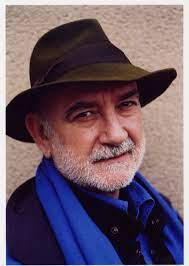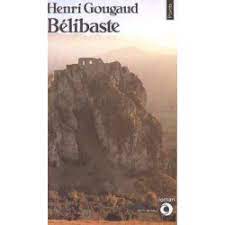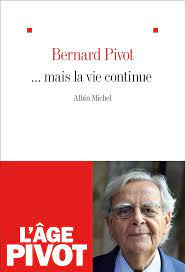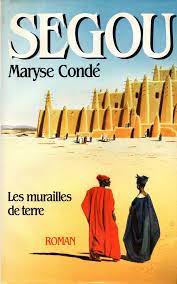L’écrivaine canadienne Alice Munro est morte le 14 mai 2024. Elle était née en 1931 dans l’Ontario. Elle écrivait des nouvelles et a été la première autrice de nouvelles à recevoir le prix Nobel pour son oeuvre, en 2013.
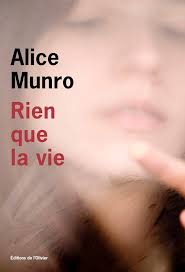
Rien que la vie. Les 14 nouvelles qui composent ce recueil sont autant de tranches de vie de leurs personnages ou de l’autrice, pour les quatre dernières qui sont présentées comme étant autobiographiques. Dans Rien que la vie Alice Munro décrit de façon émouvante sa relation à ses parents, la ferme familiale, son environnement et son attachement à ces lieux.
La plupart de ces nouvelles racontent un moment charnière dans une vie. Dans La gravière une enfant de sept ans est la protagoniste d’un drame familial. Devenue adulte, elle tente de comprendre l’événement et son propre comportement. Poignant.
La narratrice de Havre raconte comment sa tante a consacré sa vie à faire de son foyer un havre pour son mari. Jusqu’à l’erreur d’appréciation.
Dans Train un jeune homme qui revient de la guerre saute du train qui le ramenait chez lui. Il s’installe dans une ferme délabrée qu’il remet en état. C’est l’histoire d’un homme qui aime réparer des choses et qui souhaite demeurer sans attaches.
J’ai aimé le rythme lent de la vie quotidienne dont les principales péripéties sont les relations humaines sur le long terme, et les concessions qu’on fait :
« Je n’étais pas retournée chez nous pour la dernière maladie de ma mère ni pour son enterrement. J’avais deux jeunes enfants et personne à qui les confier à Vancouver. Nous n’avions guère les moyens de nous offrir le voyage et mon mari méprisait tout ce qui relevait des convenances, mais pourquoi lui faire porter la responsabilité ? Je partageais son sentiment. De certaines choses on dit qu’elles sont impardonnables, ou qu’on ne se les pardonnera jamais. Mais c’est ce qu’on fait -on le fait tout le temps. »
Les sentiments et les motivations des personnages sont analysées de façon fine, c’est une lecture que j’ai appréciée.