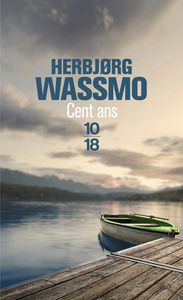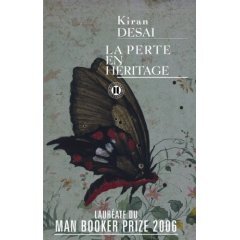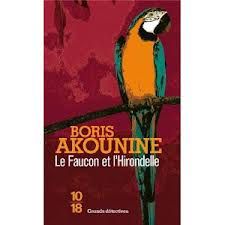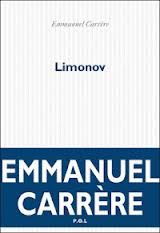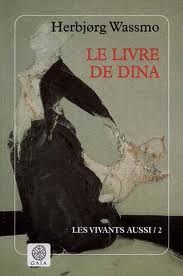
Le tome 1 ici.
Après la mort de Jacob, son mari, Dina traverse une période mutique qui se termine à la naissance de son fils. Elle se décide alors à prendre en main la gestion du comptoir de Reinsnes et impose ses choix à son entourage : elle embauche une Lapone, Stine pour être la nourrice de son fils; elle s’affronte à Niels, le fils de Jacob, pour la maîtrise de la comptabilité. Elle est régulièrement visitée par les fantômes de ceux qui ont compté dans sa vie : Hjertrud, sa mère, Lorch, son professeur de violoncelle, Jacob. Elle fait la connaissance de Léo Zjukovskij, un voyageur russe qui séjourne au comptoir.
Je retrouve avec plaisir le personnage de Dina, menant sa vie comme elle l’entend, sans se soucier de ce qu’en pensent les autres, se comportant plus souvent en homme que comme on l’attend d’une femme. (Après le dîner, elle s’installe au fumoir avec ces messieurs, boit un coup et fume le cigare). J’aime aussi ce que je découvre de cette bourgeoisie qui dans son coin reculé du grand Nord joue du violoncelle, organise de somptueux festins pour Noël et reçoit à bras ouverts les visiteurs cultivés capables de parler littérature.