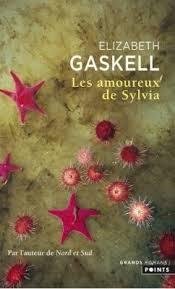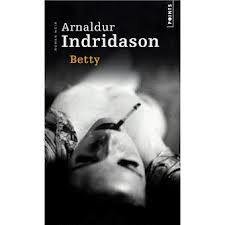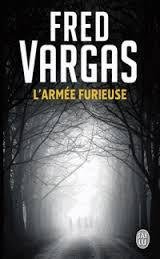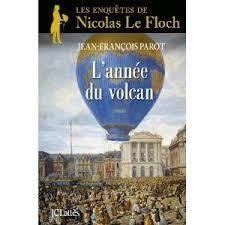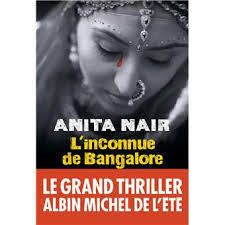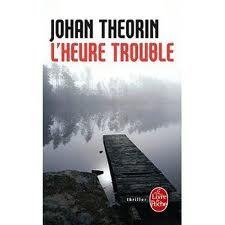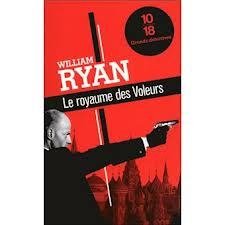
Moscou, hiver 1936. On retrouve le corps d’une jeune femme dans une église désaffectée qui sert maintenant de club à la section locale des komsomols (les jeunesses communistes). Le capitaine Alexeï Dmitrievitch Korolev, du service des enquêtes criminelles de la milice de Moscou, est chargé de l’enquête. Dès le départ il est informé par le colonel Gregorine du NKVD (la police politique) que cette affaire intéresse aussi ses services. La victime -qui a été torturée à mort de façon particulièrement horrible- serait une Américaine. Le meurtre serait lié à la vente d’objets d’arts par le gouvernement soviétique pour financer la révolution. Des membres de l’Eglise orthodoxe en exil sont très désireux de mettre la main sur une certaine icône précieuse.
Je retrouve avec plaisir le capitaine Korolev dans cette première enquête (j’avais lu le deuxième épisode précédemment) passionnante qui nous le situe dans son cadre de vie quotidien, ses relations avec ses collègues et ses interrogations : « Le fait de prier un Dieu dont le Parti affirmait qu’il n’existait pas le troubla un instant, comme tous les matins. Mais parfois, rétrospectivement, il était évident que le Parti se trompait. La preuve : regardez comme il avait nourri en son sein cette vipère de Trotski pendant des années. Peut-être découvrirait-on qu’il avait eu tort au sujet de Dieu également. Et même si ce n’était pas le cas, ça ne pouvait pas faire de mal de rester prudent en attendant. »
J’apprécie beaucoup cette série qui me met dans l’ambiance de la vie en URSS au moment où débute un train de grandes purges.