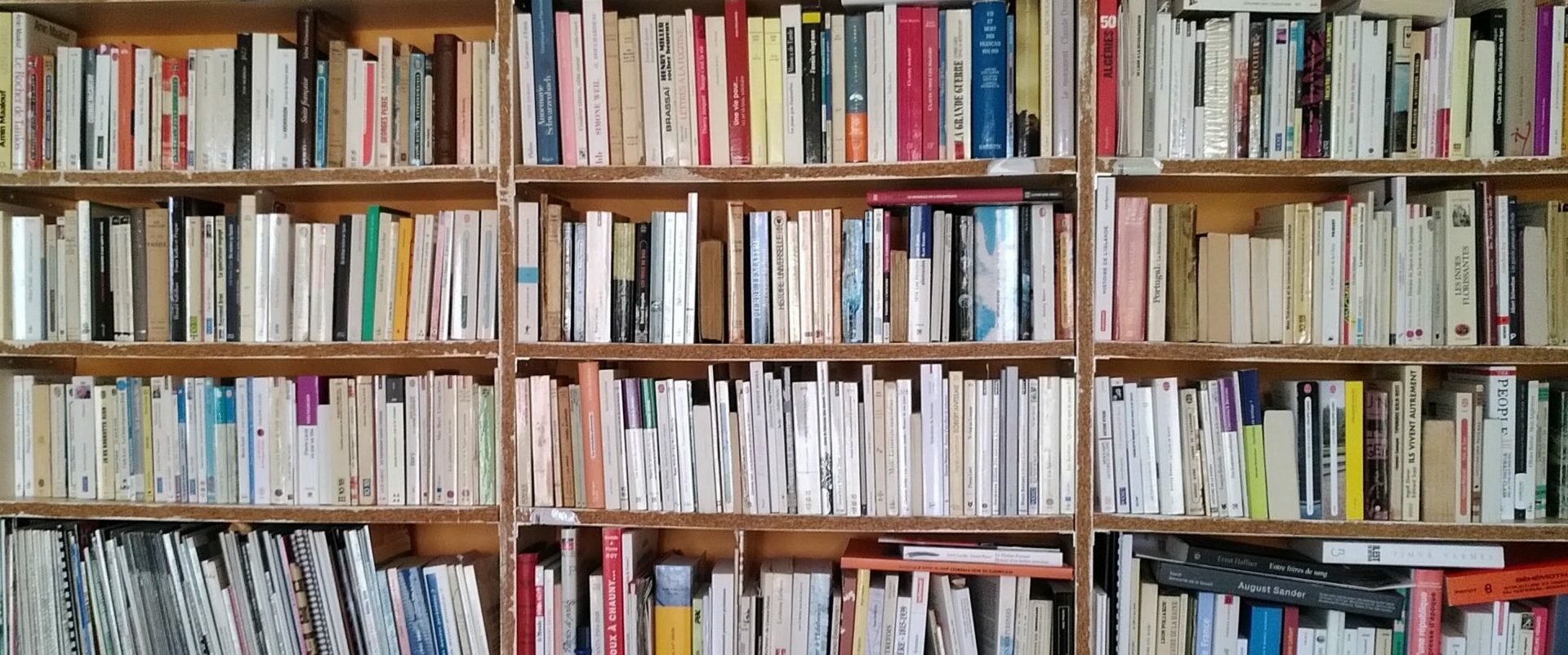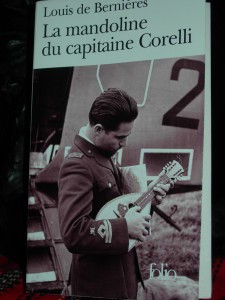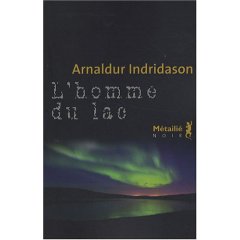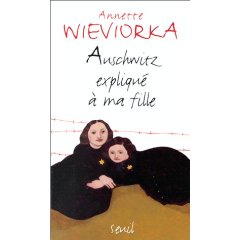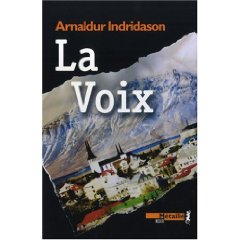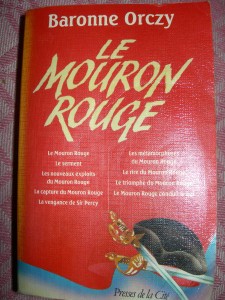
Dans la collection Omnibus, ce gros bouquin (1238 pages) comprend l’intégrale des aventures du Mouron Rouge traduites en Français. 9 romans. Je crois que je vais les lire un par un.
Le premier épisode, Le Mouron Rouge, date de 1905. La baronne Orczy (1865-1947) est née en Hongrie. Elevée à Bruxelles et à Paris elle s’installe ensuite en Grande-Bretagne où elle se marie. Elle est l’auteur de romans policiers très populaires au début du 20° siècle mais c’est le Mouron Rouge qui fait sa célébrité. Plus d’infos sur la baronne et son oeuvre par ici. Quand j’étais adolescente j’ai lu avec plaisir ces aventures dans de vieilles éditions de la bibliothèque verte héritées de ma mère dont elles avaient fait les délices avant moi. Les vacances de Noël ont été l’occasion d’emprunter la présente édition chez mes parents. Je l’avais trouvée il y a bien 20 ans chez un bouquiniste.
Mais place à l’action. 1792, Marguerite Saint-Just, femme élégante et fine, fut la coqueluche du tout-Paris avant d’épouser Sir Percy Blakeney et de devenir un élément incontournable de la bonne société londonienne. En ces temps troublés un mystérieux Anglais qui signe le Mouron Rouge (une petite fleur) accomplit des exploits incroyables en arrachant à la guillotine des aristocrates français victimes de la Terreur. La malheureuse Marguerite est alors soumise à un horrible chantage : son frère chéri Armand, resté en France, républicain modéré, s’est compromis. Qu’elle livre des informations permettant de démasquer le Mouron Rouge sinon Armand sera exécuté. Que faire ? Trahir sa famille ou trahir l’honneur ? Marguerite ne sait auprès de qui chercher de l’aide et surement pas auprès de ce grand crétin de Sir Percy qui ne pense qu’à sa garde-robe…
Quel suspense ! Quelle tension ! Les excès de la Terreur sont de plus l’occasion de superbes descriptions de la populace parisienne : « Une foule grouillante, bruissante et houleuse d’êtres qui n’ont d’humain que le nom, car à les voir et les entendre, ils ne paraissent que des créatures féroces, animées par de grossières passions et par des appétits de vengeance et de haine. » Ca, c’est la première phrase du roman, la suite permettra de détailler plus sur la malpropreté et la grossièreté des partisans de la Révolution. A côté le peuple britannique est beaucoup plus sympathique, composé de « rustres vêtus de blouses brodées et à la physionomie joyeuse et colorée. »
Je me régale aussi à lire les tourments de cette pauvre Marguerite qui manque défaillir à plusieurs reprises. Quant au Mouron Rouge, c’est Zorro avant l’heure, ma parole ! Rien d’impossible pour ce héros qui une fois sa mission accomplie rentre dans l’ombre et devient totalement insoupçonnable dans son personnage de tous les jours.