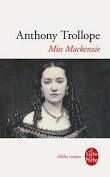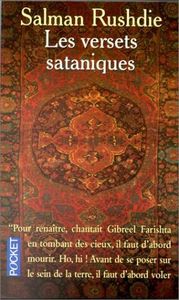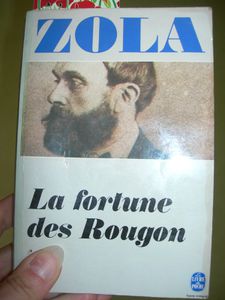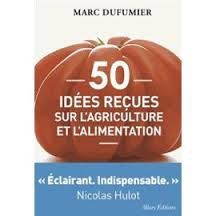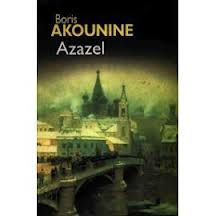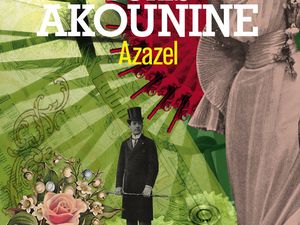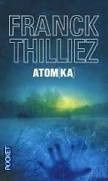Svetlana Alexievitch interroge des personnes qui ont vécu le passage de l’URSS à la Russie. Ils témoignent du bouleversement de leurs vies qui en est résulté. Les entretiens de la première partie de l’ouvrage datent des années 1990, ceux de la deuxième partie des années 2000. L’auteur s’efface derrière ses témoins et les laisse raconter, passant par les épisodes de la vie quotidienne, la famille, pour dire l’histoire.
Parmi les personnes interrogées, nombreuses sont celles qui regrettent la grande URSS. Les cadres du Parti ont perdu leur position, les personnes âgées ont perdu leur retraite et ceux-là disent qu’au moins avant on était fier d’être Soviétique, que l’URSS était une des deux grandes puissances mondiales. Les camps de travaux forcés, le goulag, sont évoqués mais ne ternissent pas la nostalgie. Pourtant d’autres n’ont pas oublié la réalité du totalitarisme :
« Quand mon grand-père était revenu d’un camp du Kazakhstan en 1956, c’était un sac d’os. On avait dû lui donner un accompagnateur tellement il était malade. Et elles n’ont dit à personne qu’il était leur mari, leur père. Elles avaient peur… Elles disaient que c’était un étranger, un vague parent. Il a vécu avec elles quelques mois, et puis elles l’ont mis à l’hôpital. Là, il s’est pendu. Maintenant, il faut… il faut que j’arrive à vivre avec ça, avec ce savoir. »
Ce qui me frappe aussi c’est l’importance de la seconde guerre mondiale, la grande guerre patriotique, comme événement fondateur autour duquel toute une propagande a été montée. Pendant 45 ans on a éduqué les enfants en leur donnant comme modèle le sacrifice des soldats russes. Mourir pour la patrie était le sort le plus doux. Aujourd’hui ceux qui ont grandi dans ce système se sentent en complet décalage face aux préoccupations matérialistes de leurs propres enfants.
La deuxième partie témoigne aussi des violences inter-ethniques qui ont marqué la dislocation de l’URSS, dans les états baltes, en Asie centrale, la guerre civile en Tchétchénie. C’est donc un ouvrage très riche qui aborde de nombreux sujets forts intéressants. Cela se lit plutôt facilement du fait de ces nombreuses histoires personnelles dont les narrateurs nous font part de leurs sentiments face aux événements qui les ont touchés.
Une blague soviétique pour terminer :
« Il y a un portait de Staline au mur, un conférencier fait un exposé sur Staline, un choeur chante une chanson sur Staline, un artiste déclame un poème sur Staline… Qu’est-ce que c’est ? Une soirée consacrée au centenaire de la mort de Pouchkine ! »
L’avis de Dominique.