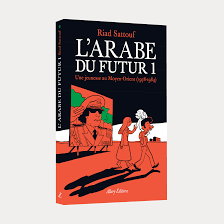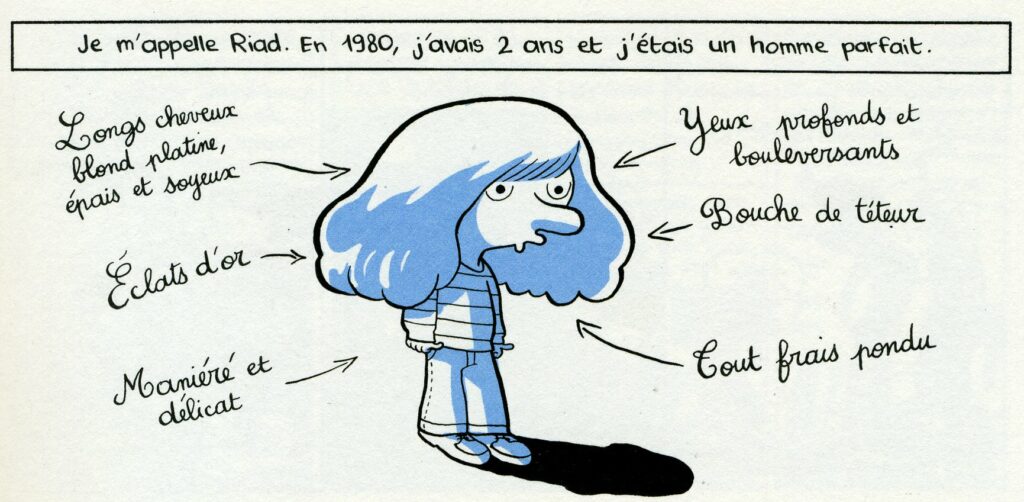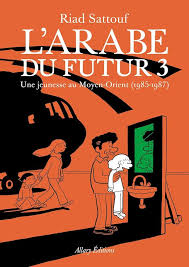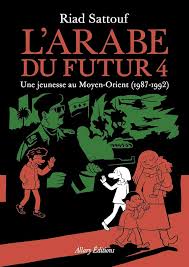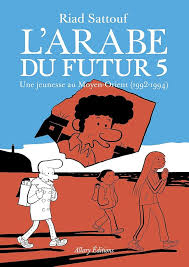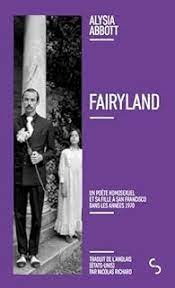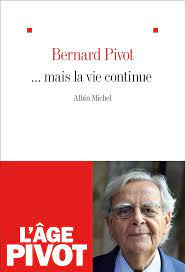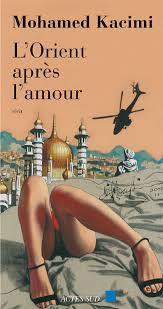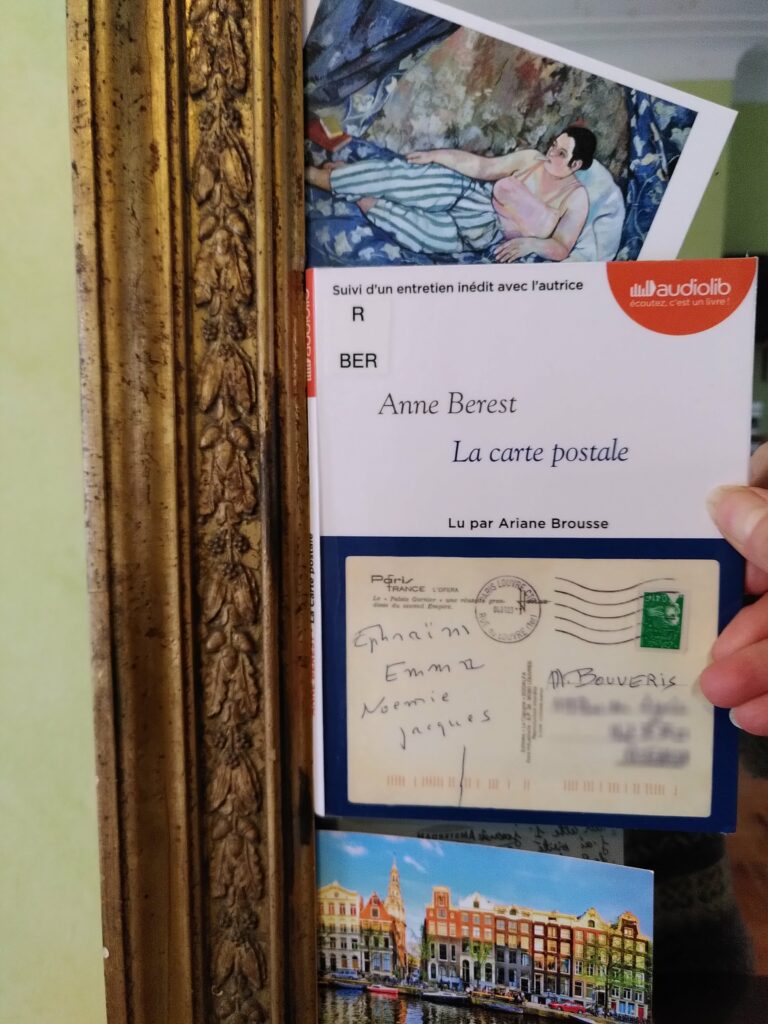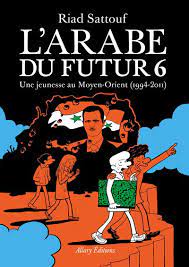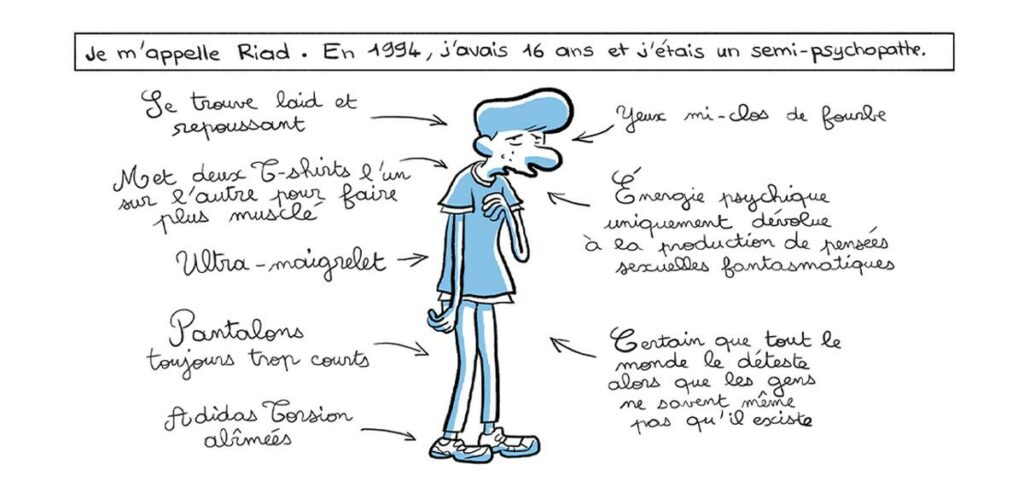Retisser nos liens dans un monde désuni. Loretta Napoleoni est une journaliste italienne spécialisée dans le financement du terrorisme. Peu avant d’écrire le présent ouvrage, elle découvre que son mari a investi inconsidérément l’argent du ménage et qu’ils sont ruinés. Elle doit vendre sa maison des Etats-Unis, hypothéquer et louer celle de Londres. Elle divorce. Cette trahison a beaucoup affecté l’autrice. Pour calmer ses angoisses et penser à autre chose elle se remet au tricot qu’elle a pratiqué depuis l’enfance et décide d’écrire ce livre. Le résultat est un mélange de récit autobiographique, d’informations historiques et scientifiques et de considérations sur le « pouvoir » du tricot.
Loretta Napoleoni a appris à tricoter avec sa grand-mère qui profitait de ces séances privilégiées pour lui raconter sa vie et lui faire part de ses considérations sur le monde. J’ai tendance à penser que l’important dans cette relation ce n’était pas le tricot mais la grand-mère et que celle-ci aurait fait passer les mêmes notions via une autre activité (la cuisine, le jardinage?)
Ce qui m’a le plus intéressée ce sont les informations factuelles, particulièrement historiques. J’apprends ainsi que l’ancêtre du tricot était le nalbinding qui se pratique avec une seule aiguille à chas. Vers 400 av. JC il est remplacé par le tricot à deux aiguilles que nous connaissons. Il est question aussi des effets positifs de l’activité tricot sur le cerveau : lutte contre le stress et développement des connexions neuronales.
Je suis plus dubitative concernant le tricot comme moyen de lutte politique : des activistes se réunissent pour tricoter ou réalisent une œuvre collective afin d’attirer l’attention sur un problème environnemental ou de gouvernance. L’autrice a à ce sujet des accents exaltés : « A l’heure où de nouveaux défis s’annoncent pour notre avenir, le tricot peut s’allier à la politique pour recoudre les fractures et reconstruire les ponts de la communication ; il peut purifier l’air pollué, assainir l’eau et faire revivre les liens sociaux ». Les liens sociaux, je veux bien ; faire prendre conscience des problèmes, aussi ; mais pour sauver la planète, à mon avis, on ne pourra pas se contenter du tricot. Il va falloir passer à autre chose.
Il y a une volonté très américaine, il me semble -Loretta Napoleoni a passé une partie de sa vie aux Etats-Unis et le livre est traduit de l’américain- de tout positiver. Le résultat pour moi manque de nuances et m’a régulièrement agacée. Un dernier exemple : « Nous, les tricoteurs, sommes unis pour toujours, reliés les uns aux autres par des mailles à l’endroit et des mailles à l’envers, interconnectés par la beauté de cet artisanat. Assemblés autour des fibres naturelles dont ce fil est fait, nous sommes les témoins de ce que l’humanité a de meilleur en elle ».
C’est donc un livre très inégal qui soulève des points de réflexion intéressants lesquels sont disqualifiés à mes yeux par ce genre d’élans mystiques sur le pouvoir du tricot. Comme s’il n’y avait pas des gens très peu recommandables qui tricotaient.
Le texte est suivi d’un cahier des modèles cités, comme le coquelicot que vous voyez dans mon panier en tête d’article. J’ai utilisé un rouge trop foncé, le résultat n’est pas très réaliste.