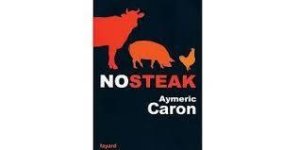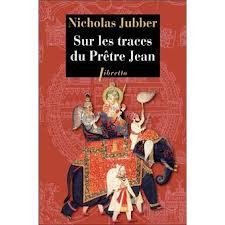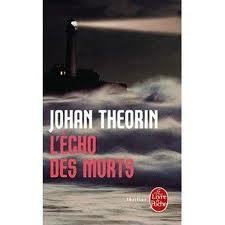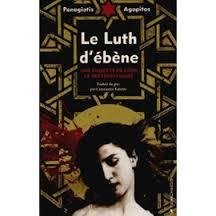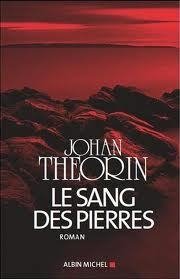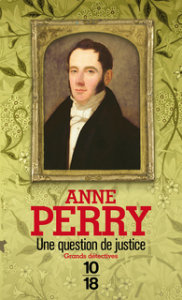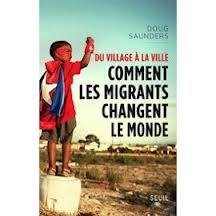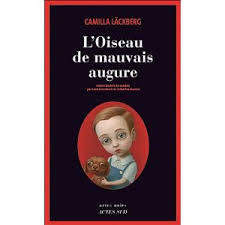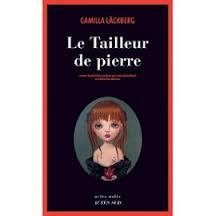
Au début je me suis demandée si je n’allais pas commencer à en avoir marre de la petite ville de Fjällbacka. Et puis j’ai été happée par un suspense haletant qui m’a entraînée jusqu’à la fin en moins de deux (jours). Fjällbacka est certes une petite ville mais tout sauf paisible.
Dans cet épisode c’est une fillette de sept ans qui est retrouvée noyée par un pêcheur. C’est un crime bien sûr et l’enquête s’annonce difficile. Ce que j’apprécie particulièrement c’est que c’est l’occasion pour Camilla Läckberg de nous présenter toute une galerie de personnages -d’inégale importance dans l’affaire, on le découvre au fur et à mesure. Certains vont se révéler jouer un rôle majeur, d’autres sont simplement là pour notre plaisir mais tous sont bien analysés ce qui donne de l’épaisseur au roman et fait pour moi son intérêt. On croise ainsi une femme manipulatrice et perverse, uniquement occupée d’elle-même et qui fait le malheur de sa famille sur plusieurs générations (tu parles d’une malédiction, ça fait froid dans le dos); une épouse soumise qui ose enfin se révolter contre son fanatique de mari; un pédophile amateur de jeunes garçons et un pasteur qui cherche l’amour.
Je retrouve aussi l’équipe du commissariat de Tanumshede. Mellberg se découvre un fils, Gösta, l’amateur de golf étonne ses collègues par ses manifestations inhabituelles et ponctuelles de compétence, Martin se met en ménage et surtout Ernst décide de prendre des initiatives pour montrer à quel point il est indispensable. Il aurait mieux fait de s’abstenir. Quant à Erica, elle vient tout juste d’ accoucher et découvre avec désespoir que la maternité n’est pas la suite de félicité qu’on lui promettait. Très impliqué par son enquête, Patrik n’est pas toujours aussi présent qu’elle pourrait le souhaiter.
Pour moi cet épisode est un des meilleurs que j’aie lus de cette série jusqu’à présent. Ca m’a tellement plu que j’attaque aussitôt le tome suivant à ma disposition.
L’avis d’Elfique.