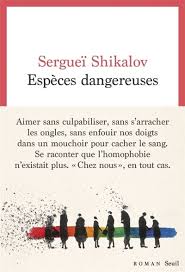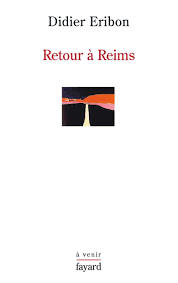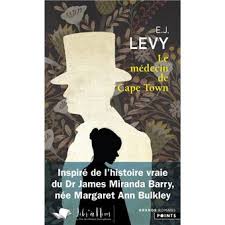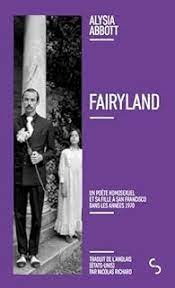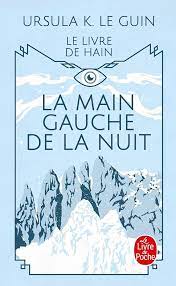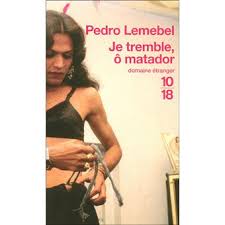
Santiago, 1986. Le mois de septembre, avec la fête nationale, est aussi celui des manifestations étudiantes contre le régime de Pinochet. Dans un quartier populaire vit la Folle d’en Face, homosexuel maniéré d’une quarantaine d’années. Il a été abordé par Carlos, un étudiant de 22 ans, qui lui a demandé s’il pouvait stocker des caisses de livres chez lui et s’y réunir pour réviser avec des camarades. Séduite pas le jeune homme et bien vite amoureuse, la Folle d’en Face a accepté. Elle joue les évaporées et feint de croire ce qu’on lui raconte mais elle sait bien au fond que c’est autre chose qu’un examen qui se prépare chez elle. Je trouve ce personnage très attachant. On le voit évoluer, s’intéresser à la façon dont le pays est gouverné et oser un petit acte de résistance contre la dictature.
En contre-point du duo amical formé par la Folle d’en Face et Carlos on suit aussi Pinochet et son épouse lors de leurs aller-retour entre Santiago et leur résidence campagnarde de Cajón del Maipo. Le dictateur est tourmenté par des cauchemars et ne supporte plus sa femme qui parle en permanence. Elle nous est présentée comme uniquement préoccupée de ses toilettes.
Le roman est une critique efficace de la violence du régime et de la fracture sociale entre les riches et les pauvres. De par son orientation sexuelle, la Folle d’en Face est une exclue parmi les exclus qui trouve un temps des points communs avec le jeune révolutionnaire clandestin. J’ai apprécié cette lecture, l’analyse des personnages et l’écriture.
La dictature de Pinochet n’a pas instauré de répression spécialement dirigée contre les personnes LGBT. C’est à cette époque qu’apparaissent au Chili les premières boîtes de nuit gays et les premiers groupuscules luttant pour les droits des LGBT.
Le Chili a légalisé l’homosexualité pour les personnes majeures en 1999 puis aligné les droits des LGBT sur les droits des hétérosexuels en matière de sexualité en 2022. Le droit au mariage et à l’adoption pour les couples homosexuels est adopté en 2021. Aujourd’hui le Chili est un des pays d’Amérique latine les plus tolérants pour les personnes LGBT en matière de législation.
C’est une lecture commune avec Ingannmic et Je lis je blogue qui croise son Printemps latino avec mon défi Juin, mois des fiertés.
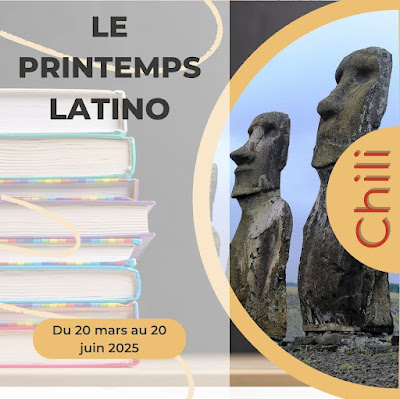


Je temble, ô matador a été adapté au cinéma en 2022 par Rodrigo Sepúlveda. Alfredo Castro est très bien dans le rôle de la Folle d’en Face. A côté Leonardo Ortizgris apparaît un peu fade en Carlos. Le film a simplifié la narration en supprimant les passages qui mettaient en scène, dans le roman, Pinochet et son épouse. Le sentiment d’appauvrissement que je ressens au visionnage me confirme qu’il vaut généralement voir le film avant de lire l’oeuvre dont il est tiré.