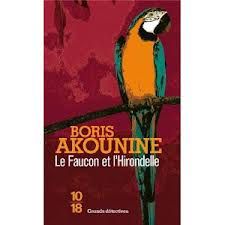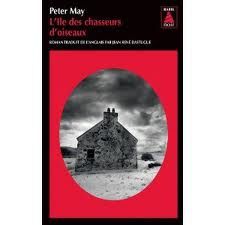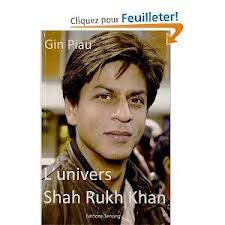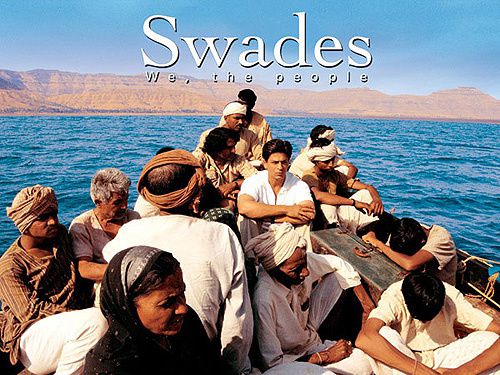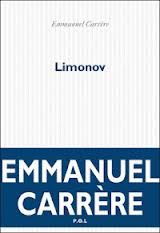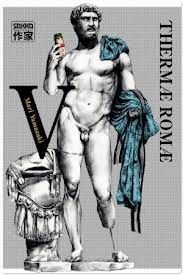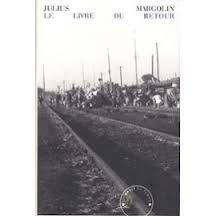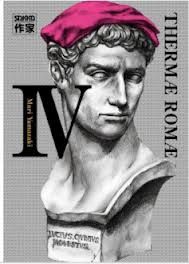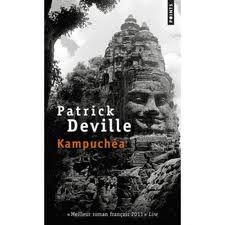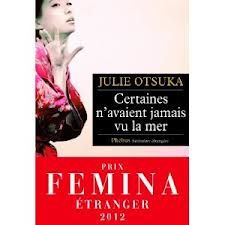Comment j’ai découvert Bollywood et Shah Rukh Khan :
En décembre 2005 je pars deux semaines en Inde avec une amie fan de Bollywwood et de Shah Rukh Khan. Elle a tenté de me convertir avant le départ en m’envoyant un ou deux films de son idole. Je me souviens avoir regardé Dilwale dulhania le jayenge*. Je l’ai trouvé long et un peu ennuyeux. Sur place le cinéma qui chante et qui danse est partout : dans l’avion, à l’hôtel, dans le bus mais ce qui conquiert mon coeur c’est le pays, la chaleur, la poussière, la nourriture, les sites, les gens…
Je reviens décidée à en approfondir la connaissance et je commence à lire tout ce qui me tombe sous la main. Mon amie m’a recommandé de regarder Swades* et Kal ho naa ho*. Je m’y mets avec un peu plus de bonne volonté et là, coup de foudre ! Dans la foulée je reprends Dilwale dulhania le jayenge : ça n’est pas ennuyeux du tout ! Sept ans plus tard l’enthousiasme de la découverte s’est un peu estompé mais j’ai toujours plaisir à regarder un Bollywood à l’occasion et je suis la carrière de Shah Rukh Khan, notamment par l’intermédiaire du site Fantastikindia.
Et voilà que Babelio propose L’univers Shah Rukh Khan dans sa dernière édition de Masse critique ! Je saute sur l’occasion de me procurer un ouvrage sur un de mes acteurs préférés.
Qui est Gin Piau ? Une fan de Shah Rukh Khan, manifestement.
Qu’est-ce que c’est que ce livre ? Un sorte d’abécédaire de Shah Rukh Khan (à partir de maintenant j’écrirai SRK), de A comme acteur à U comme UK (United Kingdom = Royaume Uni en français). Pour chaque chapitre une présentation du thème suivie de citations de la star sur le sujet. On peut ainsi apprendre ce que SRK pense (ou du moins ce qu’il en dit) de l’argent, du cinéma, des femmes, etc…
Mon avis : D’abord je dois dire que c’est la première fois que je lis un livre destiné aux inconditionnels d’une vedette. Je découvre une adoration dont je me demande si je dois la trouver ridicule ou touchante : « Shah Rukh est-il un homme ou quelque déité réincarnée ? Hanuman se penchant sur son berceau à la naissance lui aurait-il donné des dons surnaturels ? » « Il est un être extraordinaire au sens propre du terme : hors de l’ordinaire, hors du commun. Il est une source d’inspiration, un exemple, un maître à penser, une star, une icône, un phénomène. »
Les citations nous montrent que si SRK est une personnalité ouverte et tolérante -ce que ne sont pas tous les Indiens- il ne s’agit pas non plus du philosophe du siècle. Quant à moi je m’aperçois que si j’apprécie de le voir à l’écran, je me fiche un peu de savoir ce qu’il pense de ceci ou cela.
Alors, quel intérêt ? Le chapitre France fait un rapide récapitulatif des relations du cinéma indien avec la France, depuis les frères Lumière jusqu’au festival de Cannes en passant, bien sur, par l’entrée de SRK au musée Grévin.
Je découvre l’existence de Khan Abdul Ghaffar Khan (1890-1988) leader politique musulman, non-violent, partisan de Gandhi, qui s’opposa à Ali Jinnah (leader de la ligue musulmane) au sujet de la Partition de l’Inde. Une rapide recherche sur internet m’apprend que le réalisateur Sanjay Leela Bhansali a en projet un biopic de ce personnage. Voilà qui m’intéresse.
Finalement, quel bilan ? A mon avis, un ouvrage à réserver aux mordus de SRK. L’éditeur est plus optimiste : « Si vous appartenez à cette partie de la population qui ne connaît pas encore Shah Rukh Khan, voici votre chance de découvrir l’acteur, l’être humain, le présentateur, l’homme de télévision, le philosophe et les films de Bollywood. » Je crois moi que vous feriez mieux de passer par ses films. Et puis L’univers Shah Rukh Khan coûte quand même 29 €.
Dilwale Dulhania le jayenge : Raj (SRK) est un jeune NRI (Non Resident Indian = Indien expatrié). Lors d’un voyage à travers l’Europe il s’éprend de Simran (Kajol), NRI également. A leur retour à Londres le père de Simran s’oppose à l’idylle et emmène aussitôt sa fille en Inde pour qu’elle y épouse son promis. Raj la suit, bien décidé à emporter sa belle, avec l’approbation de sa famille.
DDLJ est le film qui a apporté la gloire à SRK. Il oppose une première partie comique où Raj fait le pitre pour séduire Simran et une deuxième plus tendue. L’amour triomphera-t-il face aux traditions ? La réponse est que les parents veulent le bonheur de leurs enfants et qu’ils sont donc capables de reconnaître leurs erreurs surtout s’ils ont affaire à un jeune homme décidé mais respectueux.
Swades : Mohan (SRK) est un NRI, chef de projet à la NASA, en passe d’obtenir la nationalité américaine. Un voyage en Inde pour y retrouver sa vieille nourrice va bouleverser sa vie. Sur place Mohan découvre la vie difficile des pauvres villageois, les discriminations dont sont victimes les femmes et les hors castes.
Un beau film qui donne une image assez réaliste, me semble-t-il, de la vie rurale en Inde.
Kal ho naa ho : Naina (Preity Zinta) est une jeune NRI, pilier de sa famille depuis la mort de son père. Elle n’a donc guère de temps pour penser à l’amour ou pour s’amuser. Pour elle la vie est une affaire sérieuse. Tout va changer avec l’arrivée d’Aman (SRK) qui semble décidé à lui faire découvrir le bonheur à tout prix. Mais Aman cache un terrible secret.
Après une première partie légère et amusante où on assiste aux manoeuvres de séduction d’Aman, la seconde partie est beaucoup plus dramatique avec la révélation du secret d’Aman. La fin est carrément pathétique et en fait des tonnes pour nous arracher des larmes. C’est un peu trop.