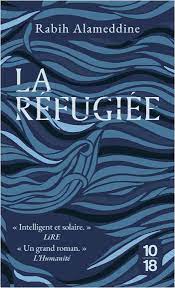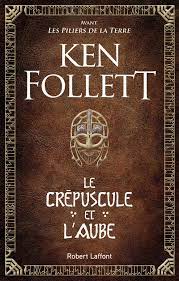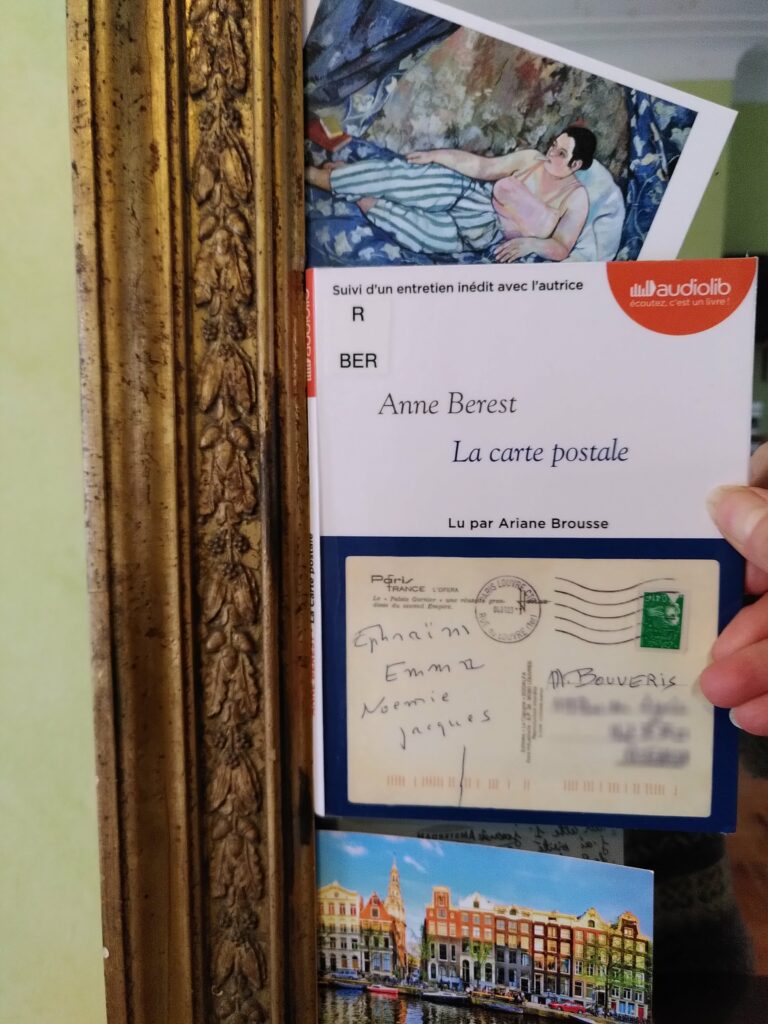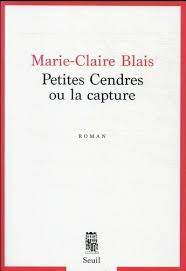A Prague, sous l’occupation nazie, le narrateur, Josef Roubiček, Juif, ancien employé de banque, survit dans une mansarde en attendant la déportation. Il a brûlé tout ses meubles pour se chauffer et pour qu’Ils (l’occupant n’est jamais nommé) n’aient rien à lui prendre. Un acte de résistance à la mesure de ce doux. Seul, sans famille, sans amis, souffrant du froid et de la faim, soumis à des humiliations et à des interdictions toujours plus nombreuses il tient le coup en se réfugiant dans les rêves et les souvenirs de sa vie passée, particulièrement celui de Růžena, une femme mariée avec qui il eut une liaison. Malgré l’interdiction de posséder des animaux domestiques il se lie aussi d’amitié avec Thomas, un chat errant qu’il accueille dans sa chambre. Mais un jour, alors qu’il prend le soleil dans un terrain vague, Roubiček fait la connaissance de Materna, un ouvrier qui l’invite chez lui.
J’ai trouvé excellent ce roman, fort bien écrit, qui fait bien ressentir comment l’accumulation successive d’interdictions parfois contradictoires, sans signification, englue petit à petit les victimes et les amène à considérer la déportation comme une solution de facilité. Jiří Weil montre aussi les événements qui rattachent Roubiček à la vie et l’amènent à envisager la possibilité de s’en sortir : un inconnu croisé dans la rue qui lui suggère d’enlever son étoile pour pouvoir prendre le tram, un miracle qui lui permet d’échapper à une rafle, un morceau de musique écouté dans un sanatorium.
Keisha, Ingannmic et Passage à l’Est proposent aussi des lectures à l’occasion du 27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la shoah.