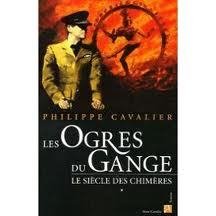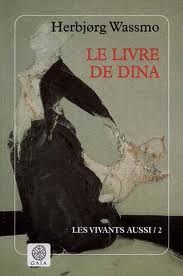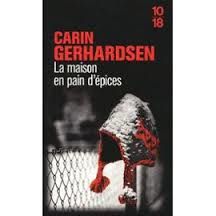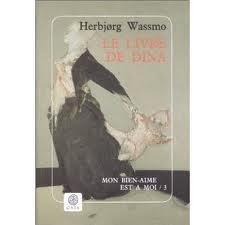
Amoureuse de Léo Zjukovskij, Dina attends avec impatience ses retours à Reinsnes. Mais Léo veut garder son indépendance et ses secrets. Il va et vient à sa guise ce qui convient de moins en moins à Dina qui n’a guère l’habitude qu’on lui résiste. Ce dernier tome nous achemine petit à petit vers une fin qui m’a d’abord choquée mais qui, à la réflexion, me paraît tout à fait cohérente avec ce que je sais de Dina.
Il se passe plein de choses passionnantes dans ce volume. L’évolution des personnages mais aussi un aperçu sur l’histoire de la Norvège dont j’apprends qu’elle eut à souffrir de la guerre de Crimée car le commerce du Nordland avec la Russie par la mer Blanche fut interrompu ce qui rendit difficile l’approvisionnement en blé de la région.
Enfin, avant de terminer, il faut que je parle de l’écriture que je n’ai pas encore évoquée. J’ai été un peu surprise par le style au départ. Il est composé de phrases courtes, voire très courtes, parfois sans verbe. Ca donne parfois l’impression que ça saute du coq à l’âne. Mais tout cela est parfaitement maîtrisé et fait bien ressentir les sentiments tout en apportant un aspect poétique au texte. J’apprécie beaucoup :
« L’équipage était de bonne humeur. Il faisait un beau temps de retrouvailles. Chacun était perdu dans ses pensées. La mer frisottait et le ciel était parsemé de tâches de crème épaisse. La crème enrobait les montagnes sans pour cela empêcher un seul rayon de soleil de passer. Le long des criques et des pointes il y avait la forêt. D’un vert brillant après la pluie. Strandstedet, autour du lac Larsnesset, s’étirait paresseusement, et l’église était un géant blanc et familier dans tout ce vert et ce bleu. »
Chaque chapitre est précédé d’un passage de l’ancien testament qui l’annonce. Dans ce volume, souvent le Cantique des Cantiques (« Mon bien-aimé est à moi ») ou le livre de Job.