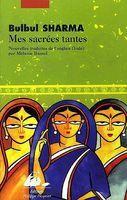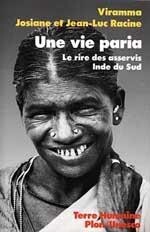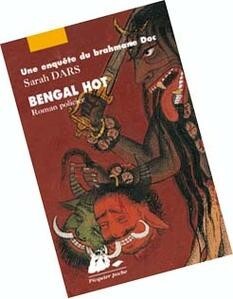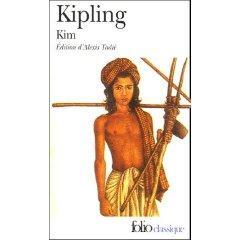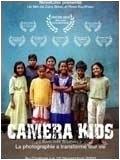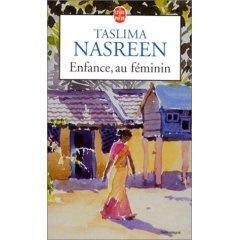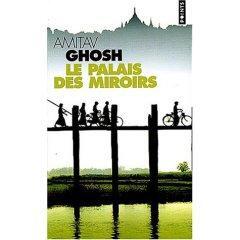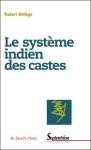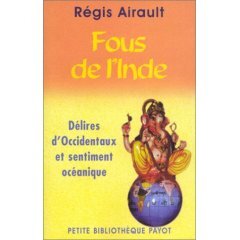
« Une vieille légende hindoue raconte qu’il fut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Comme ils abusèrent de ce pouvoir, Brahma, le maître des dieux, décida de le leur retirer et de le cacher dans un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Oui, mais où ?
Brahma convoqua en conseil les dieux mineurs pour résoudre ce problème.
– Enterrons la divinité de l’homme, proposèrent-ils.
Mais Brahma répondit :
– Cela ne suffit pas, car l’homme creusera et trouvera.
Les dieux répliquèrent :
– Dans ce cas, cachons-la tout au fond des océans.
Mais Brahma répondit :
– Non, car tôt ou tard l’homme explorera les profondeur de l’océan. Il finira par la trouver et la remontera à la surface.
Alors, les dieux dirent :
– Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou sous la mer d’endroit que l’homme ne puisse atteindre un jour.
Mais Brahma répondit :
– Voici ce que nous ferons de la divinité de l’homme : nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c’est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher.
Et depuis ce temps-là, conclut la légende, l’homme explore, escalade, plonge et creuse, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. »
Régis Airault est psychiatre. Il a été en poste au consulat de France à Bombay. Là il a constaté que le séjour en Inde pouvait déclencher chez certains occidentaux des crises de délire. Souvent les victimes de ce « syndrome indien » sont des adolescents ou de jeunes adultes. Dans la plupart des cas le rapatriement dans le pays d’origine suffit à faire disparaître les troubles.
« L’Inde rend-elle fou, ou les fous vont-ils en Inde ? » Les deux réponses sont vraies. En Inde la folie n’a pas le même statut qu’en France. Le fou, tant que son comportement n’est pas agressif, est accepté. Des symptomes qui chez nous vous feraient enfermer sont considérés là-bas comme un signe de sainteté.
Régis Airault déplore que dans les société occidentales il n’existe pas ou plus de rites de passages entre l’enfance et l’âge adulte. « Notre civilisation laisse de moins en moins de place à cette période de fragilité et de maturation qu’est l’adolescence ». Le voyage peut tenir lieu d’initiation. Cette initiation implique une mise à mort symbolique à laquelle peut correspondre la crise délirante.
Voici un livre qui est parfois un peu technique -d’autant plus qu’en matière de psychiatrie et de psychanalyse je n’ai guère de références. Cependant il s’appuie sur des anecdotes et des histoires de cas nombreuses ce qui en facilite la lecture. Mère d’adolescents, j’ai trouvé plus particulièrement intéressant ce qui concerne les difficultés de l’adolescence.