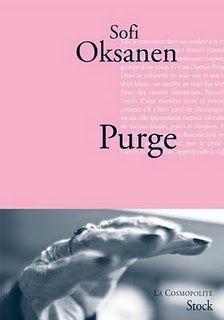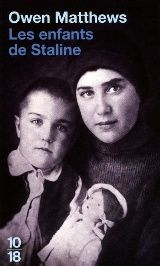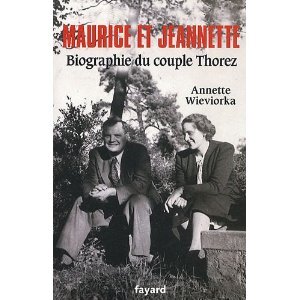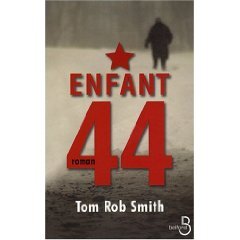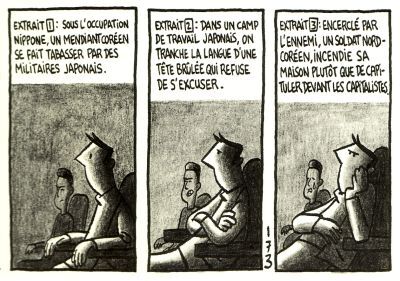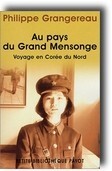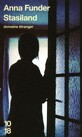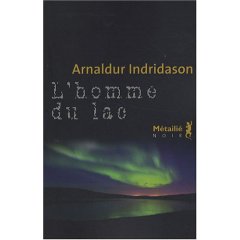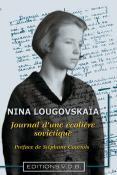Julius Margolin était un Juif d’origine polonaise. Sioniste, il a émigré en Palestine en 1936. En septembre 1939 il est de passage à Lodz quand l’Allemagne nazie envahit la Pologne. Il se réfugie dans la partie est du pays, bientôt occupée à son tour par les troupes soviétiques. Il cherche à rejoindre la Palestine par tous les moyens mais n’y parvient pas. Refusant d’accepter le passeport soviétique il est arrêté, condamné à cinq ans de détention et déporté au goulag.
« On photographia tous les prévenus et on pris nos empreintes. (…) Je ne sais plus à quelle occasion je pus voir ma photo. C’était une image terrible, et non seulement parce qu’elle était techniquement mauvaise : je ne m’étais pas reconnu. Six semaines de prison soviétique avaient détruit toute trace de vie intellectuelle : on y voyait la trogne renfermée, émaciée, poilue et criminelle d’un tueur professionnel avec des yeux écarquillés (on m’avait obligé à retirer mes lunettes) cernés de bleu et de grosses lèvres enflées. Un type comme ça méritait au moins cinq ans de travaux forcés. »
Le récit commence par un long développement sur la situation de la Pologne et de sa population (particulièrement des Juifs) pris entre le marteau et l’enclume à l’automne 1939. C’est une heureuse découverte pour moi qui me suis intéressée à ce sujet depuis quelque temps. Le gros de l’ouvrage est consacré aux conditions de détention de Margolin à travers trois camps différents. Sont évoqués le travail forcé à l’abattage des arbres, la sous-alimentation chronique particulièrement sévère en ces années de guerre où les détenus meurent littéralement de faim, les violences des gardes et encore plus entre prisonniers.
Julius Margolin est un intellectuel bien peu préparé à ce qu’il découvre. C’est à la fois sa faiblesse et sa force. Faiblesse car il est une victime toute désignée pour les droit commun qui volent nourriture et biens, force car il s’attire la bienveillance des médecins du camp et à plusieurs reprises il est sauvé in extremis. En dénutrition il est admis à l’infirmerie où les places sont comptées. Son voisin de lit meurt aussi de faim mais c’est lui que l’équipe médicale décide de sauver car elle n’a pas assez pour deux. Vous avez une famille, lui non, lui dit le médecin. Mais je sens bien qu’il y a autre chose de non-dit derrière ce choix.
En 1946 Julius Margolin rentre enfin chez lui avec l’envie de témoigner qui ne l’a pas quitté depuis son arrestation.
« Pendant ces derniers mois, souvent, dans les rues de Pinsk, j’avais vu passer des camions pareils à celui-ci et je les croyais vides; ils cahotaient bruyamment sur le pavé et, dans un coin, sur le rebord, un homme armé était assis. Ceux-là aussi étaient pleins de gens couchés, recroquevillés afin qu’aucun des passants ne pût les apercevoir. En ce moment, des gens que j’avais connus passaient peut-être et on me dérobait à leur vue. Ce régime dissimulait ce qu’il faisait derrière les ridelles vertes du camion. Et moi, étendu, je fis le serment de rabattre un jour ces ridelles vertes afin que le monde entier vît ce qu’elles cachaient. »
Voyage au pays des Ze-Ka a été publié pour la première fois en France sous le titre La condition inhumaine. Tout est dit dans cet ouvrage de la réalité du goulag que les compagnons de route du PC ont voulu taire et que le grand public n’a découvert que beaucoup plus tard. Le reste de son existence Margolin a lutté pour les détenus du goulag et ce que lui disait son entourage c’est Tu mens ou Tu as raison mais il ne faut pas le dire. Je trouve que c’est une violence supplémentaire qui s’est ajoutée à la violence qu’ont été ses conditions de survie pendant cinq ans.
« Ne te trompe pas, lecteur, et ne confonds pas les camps soviétiques avec ceux de Hitler. N’excuse pas les camps soviétique parce que Auschwitz, Majdanek et Tréblinka furent pires. Rappelle-toi que les usines de mort de Hitler n’existent plus; elles ont passé comme un cauchemar et, sur leur emplacement, s’élèvent des monuments au-dessus des tombes des victimes. Mais le 48° carré, Krouglitsa et Kotlas fonctionnent toujours, et des hommes y périssent aujourd’hui comme ils y périssaient il y a cinq et dix ans. Tends l’oreille et tu entendras comme moi, chaque matin à l’aube, venant de loin :
– Debout ! »
Voyage au pays des Ze-Ka est donc un ouvrage très intéressant mais pas toujours facile à lire parce qu’il est très long (près de 800 pages). L’avis de Dominique.