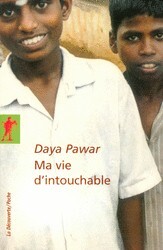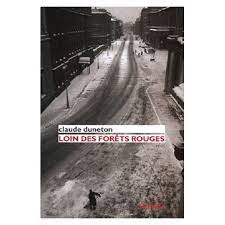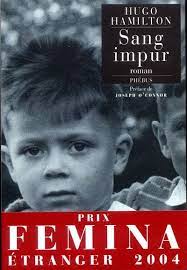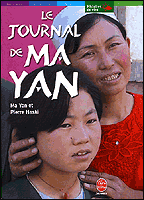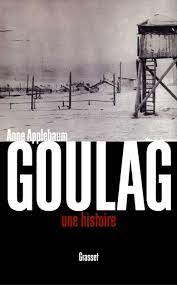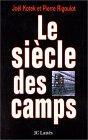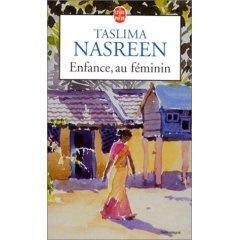
Dans ce récit Taslima Nasreen nous raconte son enfance entre la fin des années 60 et le début des années 70. Avant et après la guerre d’indépendance du Bangladesh en 1971 jusqu’en 1975, au moment de l’assassinat du président du pays, le cheikh Mujibur Rahman.
Taslima Nasreen grandit entre un père médecin, très autoritaire, qui entend que ses quatre enfants étudient et réussissent bien à l’école pour lui faire honneur et une mère qui se console des infidélités de son mari en se jetant à corps perdu dans la religion. Pour cette femme tombée sous la coupe d’un pîr (un saint homme) qui se conduit comme un chef de secte, les études ne servent qu’à attacher au monde périssable alors que le seul comportement raisonnable devrait être de préparer son passage dans l’au-delà par une pratique religieuse assidue. Entre les injonctions contradictoires de son père et de sa mère la jeune Nasreen cherche tous les espaces de liberté possibles, trouvant refuge dans la littérature et la poésie.
C’est une enfant introvertie et timide qui observe le monde qui l’entoure. Elle est prompte à relever les contradictions entre les paroles et les actes, particulièrement en ce qui concerne la religion. Elle repère rapidement les pratiques hypocrites, destinées avant tout à impressionner l’entourage. Elle interroge souvent sa mère à ce sujet ce qui lui vaut d’être qualifiée de démon et d’impie.
J’ai beaucoup apprécié ce récit. A travers son histoire Taslima Nasreen nous présente un panorama de la société bengalie d’il y a 35 ans.
C’est une société violente où les conflits se règlent par les coups. Les victimes en sont généralement les plus faibles : femmes, enfants, domestiques. Nasreen et ses frères et soeurs sont souvent battus par des parents qui les utilisent comme intermédiaires pour régler leurs différends. On entend parler de femmes tuées par leurs maris sans que ceux-ci semblent le moins du monde inquiétés.
C’est une société où les femmes sont soumises par l’islam et par les traditions régionales. Les mariages de fillettes sont arrangés alors qu’elles sont à l’école et le lendemain elles s’en vont vivre dans la famille de leur mari :
« Maman avait encore l’âge de jouer à la poupée quand on la maria à mon père, sans lui demander son avis. Au début, il lui arrivait d’insister auprès de son mari pour qu’il l’emmène à la fête foraine, faire des tours de manège, acheter des poupées, justement. Mais ces goûts enfantins durent bientôt lui passer lorsqu’elle se retrouva, vite fait, mère d’un petit garçon, tout en chair et en os. »
En fait, pour une jeune femme, le mariage est une union avec ses beaux-parents plutôt qu’avec son mari. C’est le beau-père qui choisit sa bru et qu’elle soit jeune permet à la belle-famille de terminer son éducation et de la façonner à sa guise. On voit ainsi la tante de l’auteur, jeune fille enjouée, devenir une dévote voilée après son mariage avec le fils du pîr.
Nasreen échappe au mariage précoce parce que son père veut qu’un de ses enfants soit médecin et que ses deux frères aînés ont échoué dans cette voie.
C’est une société encore pleine de superstitions et de croyances dans des forces mauvaises :
« Si une fille était mordue par un chien, la mère de Grand-mère, notre arrière-grand-mère maternelle, connaissait un médicament pour éviter que la victime ne tombe enceinte de chiots. On le préparait en introduisant dans une banane d’une qualité particulière quelque chose de mystérieux qui ressemblait à un piment rond. Pour assurer l’efficacité de ce médicament dont la fabrication demeurait secrète, il ne fallait pas manger une autre de ce genre de banane pendant trois mois. On était ainsi assuré de ne pas mettre bas une portée de chiots. On venait souvent demander à notre arrière-grand-mère de préparer cette concoction. »
L’imagination vive de Nasreen est fortement impressionnée par les histoires de fantômes et de djinns qu’elle entend et qui la font trembler de peur.
Le récit se termine en 1975 qui correspond pour l’auteur à l’époque de ses premières règles. J’aimerais beaucoup lire la suite de son autobiographie.