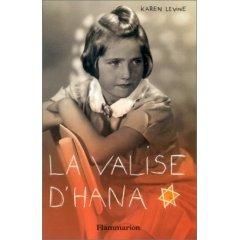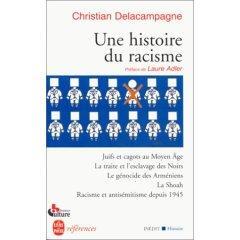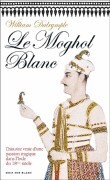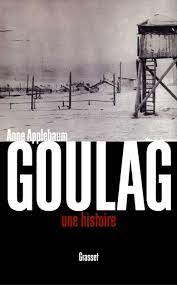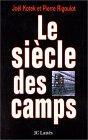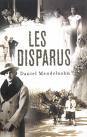
Quand il était petit Daniel Mendelsohn aimait beaucoup écouter son grand-père maternel lui raconter les histoires de sa famille venue presque au complet d’Ukraine aux Etats-Unis dans les années 1920. Ses deux soeurs fiancées (« vendues ») successivement au même cousin bossu et hideux. L’aînée d’abord puis, après sa mort (« une semaine avant son mariage »), la cadette. Son frère émigré en Israël juste à temps, au début des années 30, sous la pression de sa femme, « une sioniste ». Un seul frère était resté en Ukraine dans le village natal de Bolechow, Shmiel, l’aîné, celui dont le grand-père parlait le moins. Tout ce que Daniel Mendelsohn savait c’est qu’il avait été « tué par les nazis » avec sa femme et ses « quatre filles superbes ».
En grandissant Daniel Mendelsohn a voulu en savoir plus sur son oncle Shmiel Jäger. Après la mort de son grand-père il a recherché des survivants de Bolechow de la shoah par balles dont plus d’un million et demi de Juifs ont été victimes en Ukraine. Pour les interroger il a voyagé jusqu’en Australie, en Israël et en Suède. Il est allé à Bolechow retrouver les témoins de ce qui s’était passé 60 ans plus tôt.
Pendant cette recherche qui s’est étalée sur 5 ans il est accompagné très souvent par son frère cadet Matt, auteur de la plupart des photographies qui illustrent l’ouvrage. C’est l’occasion pour Daniel de faire enfin la connaissance de Matt car, lorsqu’ils étaient enfants, Daniel n’aimait guère Matt auquel il a même un jour cassé un bras dans un accès de rage. Cette découverte de son frère n’est pas la moindre des belles rencontres faites par Mendelsohn lors de son périple. Un aspect important Des disparus c’est tout ce pan autobiographique. En même temps qu’il enquête sur sa famille l’auteur se dévoile, interroge ses souvenirs, compare les relations qu’il imagine entre Shmiel et ses parents à celles qu’il avait lui-même enfant avec ses frères et soeur.
Les événements qui touchent la famille Jäger sont aussi mis en relation avec des passages de la Genèse analysée par deux commentateurs de la Torah, Rachi (né à Troyes en 1040) et Friedman, un contemporain, plus les commentaires personnels de l’auteur qui permettent de le connaître mieux.
Enfin les retrouvailles de Daniel Mendelsohn avec une partie du passé de sa famille sont aussi des retrouvailles avec une culture disparue, la culture juive d’Europe centrale.
Pour toutes ces raisons cet ouvrage foisonnant est un ouvrage passionnant. Daniel Mendelsohn apparaît comme quelqu’un d’intelligent, qui réfléchit, quelqu’un de bien.