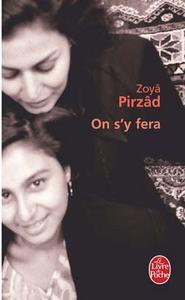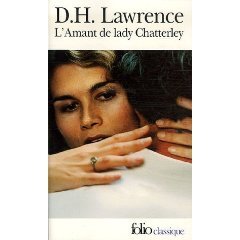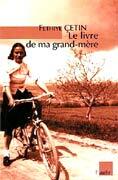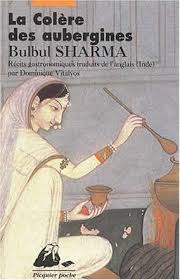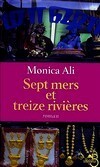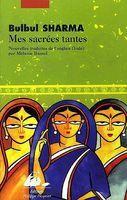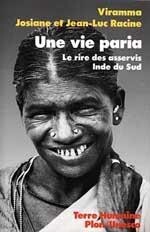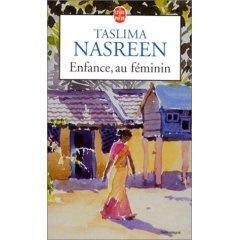Fille aînée d’une famille nombreuse et pauvre Fanny Price a été élevée depuis l’âge de dix ans par ses tante et oncle lady et sir Thomas Bertram dans leur propriété de Mansfield Park. Elle a grandi près de ses cousins, les deux aînés Tom et Edmond, déjà jeunes gens quand elle est arrivée chez eux et leurs soeurs Maria et Julia, à peine plus âgées qu’elle mais qui l’ont toujours traitée comme une parente pauvre. En fait seul Edmond s’est intéressé à Fanny, l’a consolée au moment où sa famille lui manquait et est devenu son ami et son confident. Avec l’âge les sentiments que Fanny ressent pour lui sont de plus en plus tendres.
Fanny a dix-huit ans. Chacun s’est habitué à sa discrétion, sa grande réserve, voire son excessive timidité. Elle sert de dame de compagnie à sa tante, une femme indolente qui ne quitte guère son sofa. Le départ de sir Thomas à Antigua pour affaires, l’arrivée concomitante dans le voisinage de Mary et Henry Crawford, une soeur et un frère en recherche de plaisirs faciles, vont changer beaucoup de choses.
La relecture de Mansfield Park m’a réjouie. On y retrouve tout ce qui, pour moi, fait le plaisir à lire Jane Austen. L’histoire se déroule dans le milieu de l’aristocratie campagnarde. Ses occupations simples -promenades, lectures, travaux d’aiguille pour les dames- sont opposées aux divertissements légèrement scandaleux des adeptes de la Saison en Ville personnifiés par les Crawford et Tom Bertram. Quel remue-ménage quand jeunes gens et jeunes filles décident de monter une pièce de théâtre à Mansfield. Seule Fanny reste ferme dans ses convictions, consciente jusqu’à la fin que tout ceci n’est pas convenable.
Si la morale est nettement datée, je ne m’ennuie pas un instant car Jane Austen excelle à analyser en profondeur la psychologie de ses personnages. Le fond des sentiments quant à lui (l’amour basé sur des valeurs communes) est intemporel. Le tout est fait avec beaucoup d’humour fin, les travers de chacun sont épinglés. La tante Norris par exemple, femme mesquine, est un bon élément comique, si bien observé.
Mansfield Park adapté à l’écran :
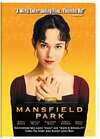
Un film de Patricia Rozema avec Frances O’Connor dans le rôle de Fanny.
C’est après m’être procurée cette adaptation (en Anglais, sous-titrée de même) que j’ai eu envie de revenir à l’original. Dans ce film Fanny est beaucoup moins introvertie que dans le livre. Son personnage est en partie inspiré de la biographie de Jane Austen. Je peux concevoir que sa personnalité très réservée, qui ne laisse voir aucun des sentiments qui l’habitent, soit difficile à porter à l’écran. Par contre ce que je trouve moins juste c’est quand le film lui fait accepter la demande en mariage de Crawford pour changer d’avis le lendemain. Il me semble que ce n’est pas du tout le genre de Fanny.
Puis le film modifie d’autres personnages d’une façon qui n’ajoute rien d’indispensable à l’histoire voire apporte un brin d’anachronisme. Lady Bertram devient une droguée à l’opium, son fils Tom un malheureux artiste traumatisé par la conduite brutale de son père à l’égard de ses esclaves. Il y a là une dénonciation de l’esclavage, Fanny apparaît comme une abolitionniste alors que dans le roman elle ne fait que poser des questions sur le commerce des esclaves comme elle en poserait, semble-t-il, sur celui de n’importe quelle autre denrée. Il y a eu une volonté de moderniser les idées et les comportements comme si le spectateur ne pouvait pas comprendre qu’on pense et qu’on agit différemment à deux siècles d’écart. Enfin la tante Norris a quasiment disparu et tout cela rend le film beaucoup moins drôle que le livre.

J’ai ensuite mis la main sur cette autre version : un film de Iain Mac Donald avec Billie Piper dans le rôle de Fanny. Ici Fanny est encore une jeune fille enjouée qui court et rit mais on est néanmoins beaucoup plus proche de la version originale.
Ce que j’ai apprécié : le caractère intéressé des Crawford est bien montré par les conversations entre le frère et la soeur et Hayley Atwell est une Mary Crawford piquante et mignonne ; la tante Norris est parfaitement aigrie et méchante ; les jeux de regards entre les personnages.
Ce que j’ai moins aimé : une traduction française acrobatique qui fait dire à Mary Crawford quelque chose comme : « Avec lequel d’entre vous aurai-je le plaisir de faire l’amour ? » (ça ne devrait pas être plutôt « faire la cour » ? ou dans la traduction de 10-18 : « Quel gentleman parmi vous aurai-je le bonheur d’aimer ?« ) ; Billie Piper a un visage trop volontaire pour le rôle, ce me semble. Et un ensemble qui manque un peu d’épaisseur. Je ne suis pas persuadée que quelqu’un qui découvrirait Mansfield Park avec ce film aurait envie de lire le livre.
Du fait du caractère de son héroïne Mansfield Park est sans doute une oeuvre difficile à adapter à l’écran et je n’ai guère été convaincue par ces deux versions.