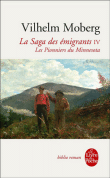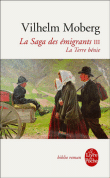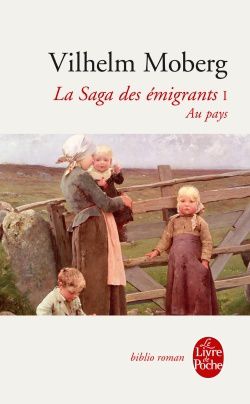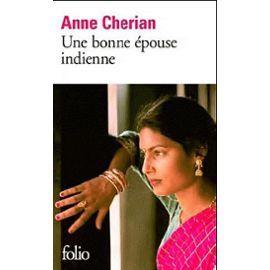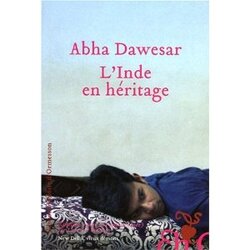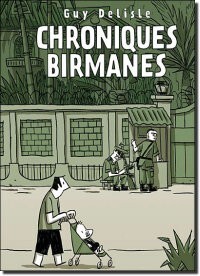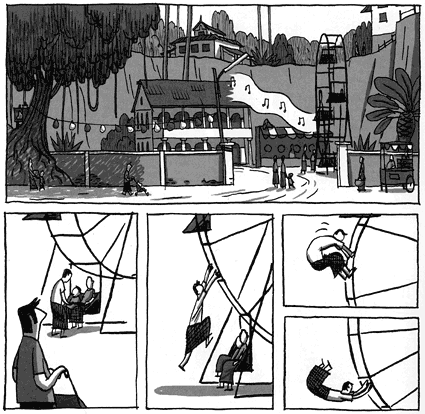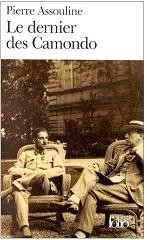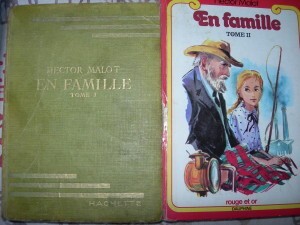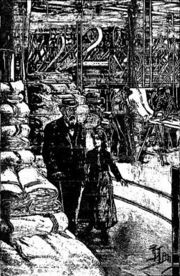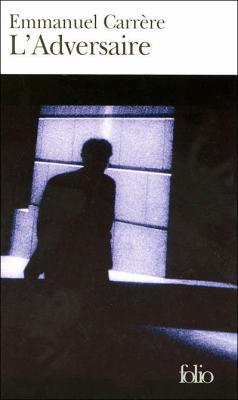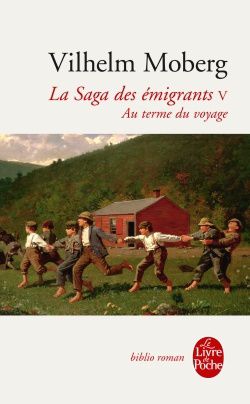
5- Au terme du voyage
L’ordinaire étant assuré Les pionniers du Minnesota peuvent maintenant envisager d’accéder à des éléments de confort. Petit à petit une cuisinière à bois, une machine à coudre, une lampe à pétrole font leur apparition au foyer de Karl Oskar et Kristina, objets dont la possession semblait inimaginable quelques années auparavant et qui font mieux mesurer le chemin parcouru surtout quand, avec des immigrants de plus en plus nombreux, arrivent de Suède les nouvelles d’une famine.
En 1858 le Minnesota devient le 32° état des Etats-Unis. Devenus citoyens ses habitants peuvent maintenant participer aux élections. Mais trois ans plus tard lorsque la guerre de Sécession éclate et que l’on recrute des volontaires pour aller défendre l’Union Karl Oskar se retrouve confronté à de nouvelles responsabilités.
Cette époque est aussi celle d’une guerre beaucoup plus proche, la révolte des Sioux du Minnesota. L’hiver 1861-1862 a été particulièrement dur, encore plus pour les Indiens de la région privés de leurs territoires de chasse et qui n’ont pas obtenu les sommes promises en échange. Ils meurent de faim. A l’été 1862 ils se révoltent en massacrant les habitants des fermes isolées. Au total plus de mille colons sont tués mais ce combat, passés les premiers moments de surprise, est perdu d’avance pour les Sioux.
Devenu un vieil homme Karl Oskar constate que si ses fils comprennent encore le suédois ils ne parlent plus leur langue maternelle et ont un peu honte de leur père qui n’a jamais appris un anglais correct.
Au terme du voyage termine parfaitement l’excellente Saga des émigrants. Je trouve très intéressante l’histoire du Minnesota dans les années 1860 et la façon dont l’auteur la croise avec celle de la famille Nilsson. Et en plus tout cela est fort bien écrit.