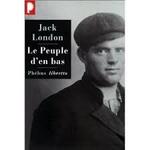
En 1902 Jack London se rend à Londres où il va vivre pendant trois mois dans le quartier misérable de l’East End. Un peu comme Florence Aubenas récemment (d’ailleurs lire Jack London m’a donné envie de lire Le quai de Ouistreham) il mène l’enquête de l’intérieur. Il ne vit pas dans les mêmes conditions que les autochtones cependant. Il a loué une chambre où il peut revenir à l’occasion passer une bonne nuit, se laver. Il dispose de moyens financiers qui lui permettent de manger à sa faim. Toutes choses dont beaucoup d’habitants de l’East End sont privés. Car ce que découvre London est effroyable.
Des salaires qui ne permettent pas de vivre de son travail. Nombre des pauvres de Londres sont en effet des sans-abris. Ce qu’ils gagnent en une journée leur permet à peine de se nourrir et pas toujours de se loger. Ils sont alors contraints de passer leurs nuits à sillonner les rues car la police est là pour veiller à ce que personne ne dorme dehors la nuit (le jour, on peut). Le lendemain ils ne sont plus vraiment en forme pour une nouvelle journée de travail. Il y a aussi les asiles de nuit mais il faut faire la queue dès le début de l’après midi pour y obtenir une place. Le lendemain il faut travailler (fabriquer de l’étoupe, trier des déchets infects) pour payer sa nuit. Cette solution n’est donc pas non plus compatible avec une activité salariée.
Etre pauvre à Londres semble être pire qu’ailleurs. D’autres observateurs que London ont déjà remarqué que les miséreux des Etats-Unis vivaient mieux que leurs homologues britanniques. 21% des Londoniens vivent de charité. Dans l’East End l’espérance de vie est de 30 ans, de 55 ans dans les quartiers ouest.
A quoi comparer l’East End ? A un bidonville : » Je regardai par la fenêtre, qui aurait normalement dû donner sur la cour intérieure des maisons voisines. Il n’y avait pas de cour -ou plutôt si, mais elle était envahie de bicoques à un étage, véritables étables à vaches dans lesquelles s’entassaient d’autres gens. Les toits de ces taudis étaient recouverts d’immondices qui atteignaient par endroits deux bons pieds de hauteur et servaient de dépotoir aux habitants du deuxième et du troisième étage de la maison où nous nous trouvions. Je discernai des arêtes de poissons, des os, de la tripaille, des chiffons puants, de vieilles chaussures, de la vaisselle cassée, et toutes les déjections d’une porcherie à trois étages. »
La précarité de la vie aussi m’a fait penser à l’Inde. On peut arriver à s’en sortir tout juste, ric-rac, en travaillant d’arrache-pied mais au moindre imprévu (accident, maladie) tout ce travail est compromis et c’est la chute. J’ai trouvé ce livre très intéressant. Les ouvrages d’Anne Perry que je suis avec assiduité se déroulent dans ce même cadre et à cette même époque mais là ce n’est pas un roman et la réalité frappe d’autant plus.
L’avis d’Isil.