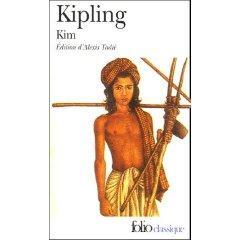
L’histoire se passe dans l’Inde britannique, à la fin du 19° siècle. Kim, un orphelin d’origine irlandaise, vit d’expédients dans les rues de Lahore où tout le monde le prend pour un Indien. Par désoeuvrement il se fait le disciple d’un lama tibétain à la recherche de la rivière sacrée qui lui permettra de s’affranchir de la Roue des Choses (du cycle des réincarnations- c’est un moine bouddhiste). Les voilà partis sur les routes de l’Inde, Kim mendiant la nourriture du vieil homme.
En route, ils croisent un régiment de soldats irlandais et Kim est reconnu comme le fils de Kimball O’Hara. Il est alors envoyé dans un lycée pour y recevoir une éducation digne de ses origines. Kim a attiré l’attention d’un officier des services secrets qui a compris tout le parti qu’il pouvait tirer d’un garçon débrouillard, capable de se faire passer pour ce qu’il n’est pas. Et le renseignement, avec ce qu’il implique de roublardise et d’adresse, tente Kim. Il accepte donc de rester au lycée mais à chaque période de vacances il repart sur les routes avec son lama à qui il s’est attaché comme à un père.
J’ai beaucoup aimé ce roman d’aventures et de formation. Rudyard Kipling écrit bien, ne dédaignant pas de se moquer des uns et des autres. Un peu de misogynie, une dose de supériorité à l’égard des basses castes, pas mal de mépris pour les Européens qui ne comprennent pas un mot d’Hindoustani. On sent bien que le personnage de Kim est son idéal : le Blanc totalement assimilé qui manie la langue locale jusque dans ses tournures argotiques, qui s’accroupit par terre et mange avec la main. Mais Blanc quand même car en même temps qu’il y a beaucoup d’amour pour l’Inde il y a aussi des préjugés raciaux.
Enfin, les pérégrinations de Kim sont l’occasion de nous donner de belles descriptions des gens et des lieux :
« Par endroits les croisaient ou les rejoignaient des villages entiers, en toilettes de fête à l’occasion de quelque foire locale, les femmes avec leurs bébés sur la hanche, marchant derrière les hommes, les garçons plus âgés piaffant à cheval sur des cannes à sucre, traînant de petites locomotives grossièrement modelées en cuivre comme on en vend pour un sou, ou envoyant le soleil au visage de leurs aînés avec des miroirs de pacotille. On voyait, au premier coup d’oeil, ce que chacun avait acheté, et, s’il restait un doute, il suffisait d’observer les femmes qui comparaient, en tendant leurs bras bruns, les bracelets neufs de verre mat qui viennent du Nord-Ouest. Ceux-là, les gens de frairies, cheminaient sans hâte, s’interpellant, s’arrêtant pour barguigner avec des marchands de sucreries, ou expédier une prière à quelqu’un des sanctuaires du bord de la route -ceux-ci hindous, ceux-là musulmans- mais que les castes inférieures de l’une et l’autre religion partagent avec une louable impartialité. »
La nymphette le 24 janvier 2008 :
Je suis tenté. Je connais Kipling pour certains propos colonialistes qui n’ont pas du tout l’air d’etre de mise dans ce roman… je note 😉
Réponse :
Quant à moi c’était la première fois que je lisais du Kipling mais non, je n’ai pas remarqué ce genre de chose.